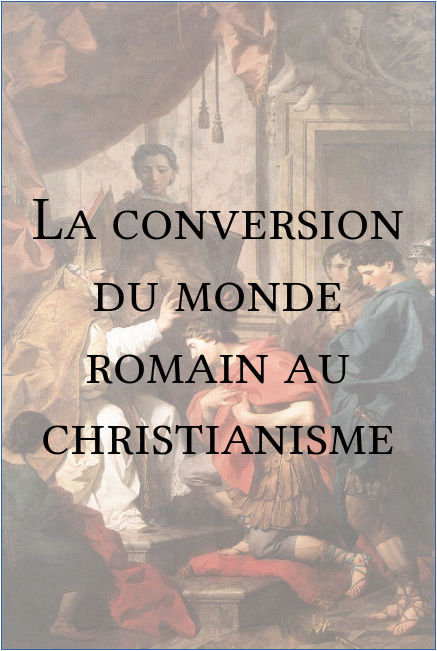
La preuve de la vérité du christianisme est la conversion de l’empire romain. Sans cette conversion surnaturelle, le christianisme n’aurait jamais pu transcender les nations. En effet, le paganisme était profondément enraciné dans cette civilisation. Lisons sans plus tarder cet indispensable texte de l’abbé de Broglié.
« La conversion du monde romain au christianisme » tiré de « Problèmes et conclusions de l’histoire des religions » de l’abbé de Broglié. Page 351 à 362.
« La conversion du monde par la prédication des apôtres a toujours été considérée comme l’une des preuves fondamentales de la vérité du christianisme. C’est un miracle d’une espèce particulière, un miracle historique. Le fait ne peut absolument pas être contesté : la discussion ne porte que sur sa valeur. Au moyen âge cet argument était considéré comme capital. C’était le seul réellement certain et indiscutable. La critique n’existant pas, il était impossible de s’appuyer raisonnablement sur les textes historiques et sur le récit de faits de détail. On n’avait aucun moyen de discerner les écrits authentiques des apocryphes. Aussi est-ce l’argument dont se sert le Dante répondant aux questions de saint Pierre sur les fondements de la foi chrétienne. Le Dante ayant d’abord allégué les miracles, saint Pierre insiste et lui dit : Mais comment prouver que les miracles se sont vraiment accomplis ? Le Dante reprend alors : Si le monde s’était converti sans miracles, la conversion elle-même serait le plus grand des miracles (Paradis, ch. XXIV, XXXIII à XXXVII). L’avantage de cet argument est qu’il repose comme le précédent sur un fait visible et sensible, sur une vérité historique : mais le fait est si vaste et si évident qu’il dispense de toute constatation fondée sur des documents spéciaux, de toute critique historique de détail.
C’est un fait qu’avant la quinzième année de Tibère il n’existait pas de chrétiens dans l’univers et que le paganisme régnait dans l’empire romain. C’est un fait qu’au temps de Constantin, près de la moitié de l’empire était chrétienne et que le christianisme était triomphant. C’est un fait que la croix du Sauveur, objet d’humiliation et de honte, supplice des esclaves, est devenue l’objet de l’adoration et de l’amour et le signe de l’honneur chez les peuples modernes. C’est un fait que les premiers apôtres qui ont prêché l’Évangile étaient des juifs, c’est-à-dire appartenaient à une race méprisée, et que tous, sauf un seul, saint Paul, étaient des hommes de basse condition et sans instruction ni éloquence. C’est un fait que la société romaine a combattu avec énergie la nouvelle doctrine, et qu’il y a eu d’affreuses persécutions. On a pu contester, à tort, mais avec quelque apparence de raison, la fréquence des martyres des premiers siècles, mais rien ne peut atténuer ce qu’ont eu d’épouvantable les persécutions de Dèce et de Dioclétien.
Le fait est donc constant, et n’a besoin d’aucune démonstration.
II ne s’agit que d’en mesurer la portée, afin de voir s’il explicable par des causes humaines.
Pour cela, nous n’avons qu’à considérer, d’une part, les obstacles que cet établissement de la religion nouvelle devait rencontrer ; d’autre part, les moyens apparents qui ont servi à l’accomplissement de cette grande œuvre. Puis, nous jetterons un regard sur l’œuvre elle-même et nous constaterons sa grandeur et sa vitalité merveilleuse.
Le premier obstacle que rencontrait la prédication des apôtres était le paganisme lui-même. Cette religion, si brillante dans ses formes, si bien adaptée aux besoins inférieurs de la nature humaine, était en possession depuis un temps immémorial de la foi des peuples. Si elle était moins puissante sur les classes éclairées, elle était considérée par les politiques comme une nécessité sociale absolue. La religion polythéiste pénétrait dans tous les détails les plus intimes de la vie ; elle était assise au foyer de la famine sous la forme des Pénales, devant l’autel desquels brûlait le feu sacré, qui était lui-même une divinité : l’idolâtrie, en rendant les dieux visibles, avait donné à leur culte un caractère éminemment populaire.
« L’enfant avait vu sa mère oindre de cire parfumée ou de baume liquide ces noires statues des Lares ; et, pâle d’émotion ou d’inquiétude, prier devant une petite image de la Fortune tenant une corne d’abondance. Sa nourrice l’avait fait monter sur ses épaules, afin qu’il put toucher de ses petites mains les pierres de l’idole. II avait vu, aux solennités domestiques, son père immoler aux dieux un agneau. Sortant de sa demeure, il n’avait aperçu dans Rome que prêtres couronnés de lauriers victimes mugissantes poussées vers les sanctuaires. Ses souvenirs étaient tout imprégnés de paganisme ; une longue chaîne de traditions et de pratiques séculaires s’était comme enroulée autour de lui (Extraits de Prudence, article de P. Allard, dans le Contemporain d’août 1884, sur la polémique de Prudence). »
Saint Paul nous apprend d’autre part que dans les boucheries on ne trouvait souvent que des viandes consacrées aux idoles, d’où résumaient pour les chrétiens de difficiles cas de conscience.
Or, il a fallu que tous ces liens fussent brisés ; il a fallu que toutes les coutumes périssent : le nouveau culte, par son principe même, était sans pitié pour tous ces usages antiques et chéris.
Le second obstacle, s’unissant étroitement au premier, était la puissance politique. L’idée de droits de la conscience que l’État dût respecter était inconnue dans l’antiquité. L’union était complète entre la religion et la société civile. Le culte national faisait partie essentielle des lois et de la constitution de la société. On ne pouvait se dérober aux obligations légales du culte que par une résistance ouverte à la société : une telle résistance donnait, avec une certaine apparence de raison, le renom de mauvais citoyen. Cette union entre le culte païen et l’ordre politique se manifestait plus étroitement encore dans les armées. Les aigles qui servaient d’étendard aux légions étaient ornées de statues des dieux : on leur offrait des libations.
II fallait que cette société entière fût renouvelée ; il fallait triompher de la résistance persécutrice du pouvoir social le plus absolu et le plus puissant qui ait jamais existé. Il fallait dissoudre tous ces liens, et faire naître une société nouvelle au sein même de l’ancienne.
Le troisième obstacle provenait de la philosophie et de la sagesse profane des Grecs. Les philosophes, sans doute, n’étaient point asservis au joug des croyances mythologiques. Ils savaient leur échapper par des interprétations allégoriques, ou même souvent les combattre directement ; mais ils n’étaient pas pour cela disposés à accepter le joug d’une doctrine étrangère prêchée par des hommes sans lettres et sans crédit, et à soumettre les spéculations de leur raison à la règle d’une rigoureuse orthodoxie. Il pouvait, sans doute, se trouver parmi les philosophes des hommes fatigués du doute et disposés à accepter une doctrine qui, sous certains rapports, ressemblait à celle de Platon, et qui était enseignée par une autorité plus haute et plus sûre. L’opposition entre le christianisme et la philosophie n’était point absolue Comme celle qui existait entre les deux cultes ennemis. Néanmoins il devait arriver que le plus grand nombre des sages de ce monde se tournassent contre la doctrine nouvelle et s’alliassent au paganisme : cette prévision a été justifiée par les faits. C’était encore une puissance redoutable dont il fallait triompher.
Le dernier obstacle provenait de la doctrine chrétienne elle-même. Elle semblait, par son premier aspect et sa forme extérieure, destinée à soulever contre elle une opposition violente. S’il ne s’était agi que de remplacer le culte des idoles par celui d’une divinité invisible, c’était déjà une tentative humainement insensée. Mais il fallait substituer à ces cultes, en union avec l’adoration du Dieu invisible, celle d’un homme, et cet homme était un Juif deux fois condamné par les magistrats de son pays et par ceux de Rome, et mis à mort d’une manière ignominieuse. C’était le Dieu dont il fallait préférer le culte à celui de Jupiter et d’Apollon, les grands deux de l’Olympe, à celui de Rome et d’Auguste, personnification de la puissance sociale, et enfin au culte des empereurs divinisés.
On se représente à quel degré une pareille idée devait blesser tous les sentiments intimes des Romains. Elle devait sembler une folie répugnante et odieuse.
Quant à la doctrine morale du christianisme, elle devait sembler insensée sous d’autres rapports ; elle devait paraître absolument inapplicable. Le christianisme défendait, comme fautes contre les mœurs, des actes qui ne semblaient mériter chez les païens aucun reproche ; il punissait de l’excommunication l’adultère, même dans le sexe masculin ; il inaugurait des principes nouveaux d’une sévérité inconnue jusque-là. Tels étaient, résumés en quelques mots, les obstacles qui rendaient humainement impossible le succès de la prédication évangélique.
Maintenant, quels furent les moyens employés ?
Ce furent quelques Juifs, pauvres, sans crédit, sans éloquence, maudits et persécutés par leur propre peuple, chassés des synagogues, qui entreprirent cette grande œuvre de la rénovation du monde.
Leur mode de prédication était simple. Il consistait à affirmer leur propre conviction, à attester le fait de la résurrection de Jésus-Christ, à menacer des châtiments futurs ceux qui adoraient les idoles, et à promettre le pardon de leur fautes à ceux qui se convertiraient. Qu’une telle prédication ait touché certaines consciences troublées, certaines âmes inquiètes, que les apôtres aient converti des esclaves, des hommes du peuple, quelques femmes, cela se comprend. Qu’il se soit rencontré, même parmi les hommes de la classe lettrée, des personnes bien disposées qui aient été touchées par la vertu des chrétiens, cela s’explique encore. Les conversions individuelles, quand elles ne sont pas instantanées comme celle de saint Paul, sont des faits qui ne sortent pas de l’ordre commun.
Mais comment avec de si faibles moyens ébranler une société entière ? Comment amener des multitudes à embrasser une doctrine nouvelle, comment produire, en faveur d’une religion si contraire aux idées régnantes, un courant d’opinion suffisant pour que le nombre des chrétiens devint considérable, relativement à la masse de la population !
Cent cinquante ans environ après le commencement de la prédication des apôtres, Tertullien nous dit que les chrétiens remplissaient les armées, les villes, les sénats, et ne laissaient aux païens que leurs temples ? Ces paroles étaient sans doute entachées d’une certaine exagération ; mais le seul fait qu’elles aient pu être placées dans un écrit destiné au public prouve un immense développement de la nouvelle doctrine. Ce développement si rapide est tout à fait hors de proportion avec l’effet naturel de la parole de quelques hommes obscurs prêchant une doctrine qui combat l’orgueil et les passions.
À défaut de cause extérieure, on a supposé une cause naturelle interne. On a dit que la société païenne était travaillée du besoin d’un renouvellement religieux ; que les âmes, peu satisfaites des doctrines régnantes, étaient prêtes à en accepter d’autres, en un mot que le monde ancien portait en germe un monde nouveau.
Une telle explication, quand elle est donnée sans commentaires et sans étude détaillée des tendances réelles de l’antiquité, ressemble beaucoup à la vertu dormitive de l’opium, dans la comédie de Molière. Elle revient à dire : Une nouvelle religion s’est produite ; donc elle devait se produire. Elle ne montre nullement que cette production ait eu lieu d’une manière naturelle, en vertu de causes humaines préexistantes. C’est une explication vaine et purement verbale.
Que si maintenant l’on cherche à découvrir les véritables aspirations de la société païenne des premiers siècles de notre ère, on trouve sans doute qu’elle sentait le besoin de plusieurs des bienfaits qu’apporta le christianisme ; elle pouvait désirer l’établissement d’une idée plus élevée de la dignité que celle que contenait la mythologie païenne, l’abaissement des barrières nationales et la création d’une religion universelle. On peut croire aussi qu’il y avait une certaine tendance vers l’idée de l’égalité entre les hommes, et vers la suppression des abus de l’esclavage, bien que les jurisconsultes de cette époque maintiennent la dureté des anciennes formules.
Le christianisme a satisfait à ces tendances, mais il n’était pas le seul moyen de réaliser ces aspirations de certains esprits. La philosophie permettait de se faire une idée élevée de la divinité ; le stoïcisme prêchait une morale sévère ; la législation pouvait s’adoucir et s’est
adoucie sans changement de culte ; des œuvres de bienfaisance pouvaient être fondées et l’ont été réellement. Enfin, s’il s’était seulement agi d’un changement de culte, les sauveurs, les messies, les prophètes ne manquaient pas. Sans parler des sectes gnostiques qui commencent dès le premier siècle, les sectateurs des cultes orientaux, les adorateurs d’Isis et de Mithra, étaient répandus dans l’empire et offraient à tous cette rénovation religieuse qu’ils cherchaient.
Pourquoi donc la société païenne aurait-elle été s’adresser à ces juifs méprisés, qui ne voulaient la sauver qu’en la forçant à renier ses dieux, à bouleverser ses institutions, à adorer un crucifié, à embrasser une morale austère, à se soumettre au culte exclusif du Créateur, et à plier sa raison devant de profonds mystères ? Pourquoi est-ce le culte le plus détesté, le plus persécuté, celui auquel Tacite impute comme reproche principal la haine du genre humain, qui seul a pu grandir, qui seula vu se multiplier ses disciples au milieu de la persécution, et qui a fini par s’emparer de la société tout entière ?
Jamais les tendances de la société païenne n’expliqueront une révolution pareille, ou plutôt, s’il faut l’attribuer aux tendances et aux aspirations spéciales des habitants de l’empire romain, ces tendances et ces aspirations elles-mêmes, cette préférence pour le culte du Crucifié et la morale évangélique parmi toutes les doctrines du Monde, sont des faits miraculeux et surnaturels. Des tendances et des aspirations de ce genre ne sont pas celles de la nature, ce sont celles de l’Esprit-Saint.
Quant à la conséquence de cette grande révolution, quant à l’œuvre produite par la prédication apostolique, elle présente encore des caractères incomparables et transcendants.
En premier lieu, c’est une œuvre définitive ; le paganisme est détruit sans retour. Tout l’ordre des idées auxquelles correspondait la mythologie antique s’est écroulé pour ne plus renaître. Après l’essai de réaction de Julien l’Apostat, le paganisme se hâte vers sa ruine, et dès lors ses plus chauds partisans n’ont pas osé même prévoir sa résurrection.
En second lieu, cette œuvre est vitale et progressive. La grande transformation de la société païenne n’était pas encore achevée, que déjà il fallait en entreprendre une autre ; il fallait façonner et mouler les Barbares pour qu’ils entrassent comme éléments dans une civilisation nouvelle. Si, au lieu d’être une œuvre originale, le christianisme avait été le résultat des tendances de l’ancienne société, et le fruit tardif du vieux monde, aurait-il été adapté à la création de ce monde nouveau ? Aurait-il ainsi conquis les vainqueurs et les conquérants de l’ ancien monde ?
Ici nous nous arrêtons, car la preuve du christianisme par sa fondation miraculeuse se rejoint à une autre preuve, celle qui s’appuie sur sa durée, sur sa résistance séculaire aux attaques de ses ennemis, et sur son caractère progressif. Nous avons déjà indiqué cet argument dans un chapitre précédent. Il n’entre pas dans notre plan d’y revenir. Ce qui regarde spécialement le sujet de cette étude, c’est la question de savoir si l’histoire des religions fournit des exemples de faits assez semblables à la conversion du monde païen pour pouvoir lui être opposés et en atténuer la force probante. Or, il n’est que deux religions dont la propagation puisse être comparée à celle du christianisme, l’islamisme et le Bouddhisme. L’islamisme est mis facilement hors de cause. Une religion sensuelle, qui autorise la satisfaction des passions et qui se propage par le sabre, est si différente du christianisme, elle a des moyens de succès si distincts et même si opposés à ceux de l’Évangile, que la comparaison est inutile. La propagation de l’islamisme peut être un problème historique, mais la solution de ce problème, quelle qu’elle soit, n’ébranle en rien l’évidence de ce fait, qu’une force surnaturelle était nécessaire pour faire triompher le christianisme dans le monde.
C’est la propagation du bouddhisme qui est la véritable objection moderne contre l’argument tiré de la conversion du monde romain. Le bouddhisme, en effet, a deux ressemblances avec le christianisme. Il enseigne une morale pure, et sa propagation s’est faite par la persuasion et non par la force. Enfin il est arrivé, très lentement, il est vrai, à une très grande extension dans l’Asie et possède un nombre immense de sectateurs. II y a néanmoins, pour peu qu’on y regarde de près, une immense différence entre la nature et la destinée de ces deux religions. Le christianisme est une loi divine qui s’impose d’une manière obligatoire à tous les hommes. Il a prohibé absolument toute idolâtrie, tout culte rendu aux dieux païens, et par conséquent le culte des dieux nationaux et la religion impériale dont Rome et Auguste étaient les divinités principales. À cette loi rigoureuse, il joignait celle du mariage indissoluble et la prohibition de tout désordre de mœurs, même chez les personnes non engagées dans le mariage. Enfin il imposait à l’intelligence de lourds mystères, et en particulier l’adoration du Crucifié. Le bouddhisme ne nous présente rien de pareil. Bien loin de combattre les superstitions, il les admet dans son sein et les laisse entrer dans le cadre de sa doctrine. Sa morale est pure, mais elle contient plus de conseils que de préceptes. Le bouddhisme ne parle pas au nom d’un Dieu ; il invite les hommes à la vie de renoncement, mais ne change rien aux mœurs sociales ni surtout à la loi du mariage. Il n’impose aucun mystère, et les bouddhistes modernes du Japon se félicitent de ce que leur religion ne leur impose pas même la foi à un Dieu créateur. Le christianisme a été prêché par des apôtres ignorants. Le bouddhisme, dont le fondateur est le fils d’un roi, devenu un ascète illustre et vénéré, est adopté et prêché dès l’origine par des hommes des classes supérieures, des brahmanes et des kshattryas. Le christianisme soulève une violente opposition provenant de l’antagonisme de ses principes avec ceux de la société gréco-romaine. Le sang versé et la violence des édits donnent la mesure de la grandeur de l’œuvre accomplie. On ne réforme pas impunément des coutumes perverses qui ont une haute antiquité. Les persécutions du bouddhisme sont au contraire purement légendaire (Barth. Religions of India, p. 133). Il a été toujours protégé par les souverains, et, comme nous l’avons indiqué, il a eu son Constantin avant d’avoir son Dèce et son Dioclétien. Son succès dans l’Inde n’a été que passager : dans les autres parties de l’Asie, il a subsisté jusqu’à nos jours, mais il s’est presque partout transformé en grossière superstition ; il n’a créé que des sociétés demi-barbares telles que celle du Thibet et de Ceylan ; il n’apporte dans l’univers aucune idée nouvelle, et aujourd’hui sa décadence est évidente. On voit donc que, par d’autres raisons que celles qui concernent l’islamisme, la propagation du bouddhisme doit être considérée comme un fait de nature absolument différente de celui de la conversion du monde romain par les apôtres. L’explication de l’un ne peut résoudre le problème que soulève l’autre. Nous avons d’ailleurs exposé plus haut quelques considérations sur les causes de la propagation du bouddhisme. Ici encore, l’objection tirée des religions païennes s’évanouit comme un fantôme, et les bases de l’apologétique chrétienne subsistent sans être ébranlées.»
- Spoiler:
 Bienvenue sur le Forum catholique
Bienvenue sur le Forum catholique









